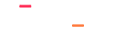La tragédie du désir
Modifié le :

Entretien avec Anne Delbée
Grande femme de théâtre, dépositaire de la plus pure tradition tragique et spécialiste incontestée de Racine, Anne Delbée aime s’atteler aux drames les plus brûlants. Après une mémorable mise en scène de Norma en 2019 sur la scène du Capitole, elle se plonge cette fois dans le bouleversant Viol de Lucrèce de Britten et nous en révèle le secret : il n’y a de tragique que le désir.
Lucrèce, vous parlez de « nuit de foudre ». Que voulez-vous dire ?
Il y a des nuits où la foudre illumine la chambre d’une lumière telle que la vie ne pourra plus jamais reprendre son cours. La « Nuit de feu », fulguration mystique qui marque la conversion de Pascal, est une de ces nuits. Le viol qui foudroie Lucrèce en est une autre. Alors oui, c’est l’histoire d’un viol, un fait probablement réel qui s’est produit en 509 av. J.-C, un épisode de l’histoire romaine rapportée par Tite-Live. Mais une fois rappelé cela, on n’a encore rien dit : ce n’est pas pour Britten un fait à traiter, mais le symbole d’une question à la fois éthique et esthétique. C’est la rencontre du désir d’un homme qui veut absolument « connaître », c’est-à-dire posséder une femme dont la beauté le perd. Comment s’approprier la beauté ? L’appropriation se fait alors destruction, la connaissance viole l’innocence. Alors le bien et le mal se fracassent l’un contre l’autre. La révélation est quasi religieuse. À travers ce viol, Benjamin Britten plonge dans les abîmes de l’âme humaine en proie à l’obsession de la pureté perdue, à la dimension tragique du désir destructeur.
Le tragique, c’est le désir ?
Le désir est tragique, et la tragédie est l’expression pure du désir qui rend fou. Dans le cas de Tarquin, c’est non seulement la beauté de Lucrèce, mais son inaccessible vertu qui le rend fou. La beauté attire le désir comme le bien attire le mal. Est-ce pour Britten le souvenir de sa jeunesse violée, soit à South Lodge, soit au collège Gresham’s School, qu’il a évoqué parfois avec pudeur ? Toute l’œuvre de Britten tourne autour de l’innocence sacrifiée. Mais aussi de la douleur tragique suscitée par la beauté. Voyez sa réaction après l’audition du Chant de la terre de Mahler : « C’est une chose cruelle, vois-tu, que la musique soit aussi belle. C’est la beauté de la solitude et de la douleur […]. La beauté de la déception – et de l’amour jamais comblé. » Que se passe-t-il quand on désire ? Un corps dégage quelque chose qui réveille une pulsion irrépressible. On veut percer le mystère, posséder, dévorer. La transgression est malentendu sur le corps de l’autre. C’est cela, le viol tragique – je veux dire, non pas la sordide réification du corps de l’autre dans les viols commis tous les jours, mais le viol transfiguré par l’opéra de Britten : l’impossibilité de croire à la limite du corps de l’autre, qui vous happe. D’une certaine façon, c’est la même chose dans Tristan et Isolde : non pas le viol, mais le passage à la limite, la monstruosité du désir de Tristan qui happe Isolde dans la mort. Le Viol de Lucrèce ne parle que de cet engloutissement.

L’opéra est composé en 1945-1946, juste au sortir de la guerre. Cela a-t-il son importance ?
Bien sûr. Très vite, Britten a été inquiété pour ses positions résolument pacifistes, ce qui l’a conduit à s’exiler aux États-Unis en 1939 ; mais en 1942, il décide de rentrer en Grande-Bretagne et de déclarer son statut d’objecteur de conscience. Par ailleurs, en 1945, il a été profondément marqué par sa visite du camp de Bergen-Belsen où, devant les rescapés, il a joué aux côtés du violoniste Yehudi Menuhin : il a fait de la musique devant l’humanité violée. Son art s’en est chargé de plus de compassion. La leçon politique du Viol de Lucrèce est sombre : l’humanité se fracasse contre la volonté de puissance des prédateurs. À cet égard, le personnage de Junius est édifiant : c’est lui, et non Tarquin, qui lance le pari insensé de la vertu de Lucrèce, et lorsqu’advient le scandale du viol et du suicide, il laisse éclater sa joie féroce et glaçante : « Romains, aux armes ! Voyez ce qu’ont fait les Étrusques ! Détruit par la Beauté, leur trône tombera… […] Et c’est moi qui gouvernerai. ». Le mythe républicain en prend un coup : il ne s’agit que de prendre le pouvoir.
Mais Britten n’en reste pas là. Sa réinterprétation religieuse du mythe politique suscite beaucoup d’interrogations…
Oui, le tournant religieux et la référence à la passion du Christ imposés par Britten sont longtemps restés un mystère pour moi. Il ne voulait pas que l’ouvrage finisse sur le mal et la désespérance, la rédemption devait devenir, au dernier moment, l’essentiel. In extremis, Britten a demandé au librettiste Ronald Duncan d’ajouter un épilogue qui relise la tragédie à la lumière de la Rédemption. Il ne pouvait admettre que l’opéra se conclue avec la mort, le néant, l’échec. Le Christ est l’innocence par excellence. Comme lui, Lucrèce se sacrifie pour l’humanité accablée par le mal. Or, paradoxalement, c’est un choix fondamentalement esthétique : « Je me suis aperçu, dit Britten, que l’opéra était musicalement incomplet ». C’est la musique qui doit nous sauver, comme le suggèrent les derniers vers : « À présent, avec ces mots usés et ces brèves notes, tâchons d’apprivoiser le chant de l’humaine tragédie ». La musique sauve le monde, et ce n’est plus Lucrèce, mais Britten lui-même, qui reçoit une dimension christique.
Vous avez, adolescente, assistée à une représentation de la pièce d’Obey, dont est tiré le livret. Quel en est votre souvenir ?
C’était en 1961 à l’Odéon, par la compagnie Renaud-Barrault, auprès de laquelle je traînais presque tous les jours. Simone Valère et Jean-Louis Barrault interprétaient Lucrèce et Tarquin, Madeleine Renaud et Jean Dessailly étaient les récitants. J’avais quinze ans et j’en garde un souvenir très fort. Puis-je l’avouer ? J’avais été fascinée par Tarquin. Je crois que Britten lui-même était fasciné. Il y a dans le livret une phrase très troublante de Lucrèce adressée à Tarquin : « Dans la forêt de mes rêves, vous êtes toujours le tigre. ». Je crois qu’aujourd’hui, nous sommes devenus incapables de penser le désir, sa violence, son immoralité foncière. Que la morale et le droit soient là pour nous en protéger, c’est très bien – mais devons-nous pour autant refouler ce qu’il en est de sa nature, c’est-à-dire de la nôtre ? Devons-nous oublier que Racine est immoral, obscène, violent ? La tragédie n’est pas une scène de ménage. Aujourd’hui on ne montre plus que l’anecdote, on ne comprend plus rien au tragique.
La musique n’est-elle pas tragique en elle-même, expression immédiate du désir ?
Absolument. C’est la musique qui est première, je ne prends conscience qu’aujourd’hui de ce que j’ai cherché pendant cinquante ans. Même au théâtre, il s’agit de musique. La première pièce à laquelle j’ai assisté, à treize ans, c’était Tête d’or de Claudel, mis en scène par Barrault, avec Alain Cuny dans le rôle-titre, qui était absolument hypnotique. Le texte est réputé difficile, mais j’ai tout compris, immédiatement, comme si chaque mot entrait dans ma peau. Dès cet instant, seule la tragédie m’a intéressée, c’est toute ma vie. Les mots tragiques sont comme des notes musicales. La comédie, ça parle, ça rit, ça crie, mais ça ne chante pas. Et je n’y comprends rien. On s’est beaucoup moqué de ma sempiternelle « grandeur tragique », maintenant cela m’est égal, j’en suis même ravie. À mon âge, je commence à devenir intéressante, après avoir cassé les pieds à tout le monde pendant cinquante ans avec la tragédie, on finit par se dire que ce n’est pas si mal ! (rires). Pour revenir à la musicalité : on comprend dans ces conditions mon attirance pour l’opéra (pas tous : j’ai adoré monter Don Giovanni, mais je serais incapable de m’atteler aux Noces de Figaro ou à Cosi fan tutte, parce que je n’en saisis pas l’enjeu tragique). Alors imaginez quand j’ai entendu la musique de Britten, c’était fou ! C’est au plus haut point une partition du désir, la musique en suit les moindres inflexions – en cela c’est comparable à Tristan et Isolde.

Comment avez-vous travaillé pour cette mise en scène ?
D’abord je me plonge dans une énorme quantité de données biographiques : je cherche l’humain qui a écrit ça, je suis obsédée par l’auteur, pour comprendre ce qui a guidé sa main. Je dois tomber amoureuse : ce fut le cas pour Britten, comme pour Bellini quand j’ai monté Norma au Capitole. Sinon je ne peux rien faire, rien voir. Alors, tout à coup, je vois quelque chose et je dois le faire absolument. Pour Le Viol de Lucrèce, j’ai soudain eu la vision d’un bateau, le mât comme une croix, le naufrage de l’humanité. Telle fut la première réflexion que j’ai confiée au merveilleux scénographe Hernán Peñuela. Je n’avais pas jusqu’alors réalisé à quel point Britten était lui-même, dans sa vie et dans son œuvre, indéfectiblement lié à l’océan, à l’eau qui vous engloutit comme un viol. L’autre image génératrice, apparue en relisant Tite-Live, c’est le dîner entre hommes par quoi l’action commence. Des hommes ivres, brutaux, qui font des plaisanteries de corps de garde. Croyez-bien que j’en ai connus, de vrais voyous. Vulgaires, lamentables, infantiles, des types vantards et alcoolisés qui jouent le destin des femmes et de la guerre. Et je pense à cette citation d’Andromaque : « La victoire et la nuit, plus cruelles que nous, / Nous excitaient au meurtre et confondaient nos coups. » Tout part de là.
Femme de théâtre, comment dirigez-vous les chanteurs ?
Acteurs, chanteurs, une chose est commune : mettre les corps en mouvement de telle sorte que s’exprime avant tout le désir. Comment le désir circule-t-il dans les mains, les bras, les jambes ? Il transfigure les corps, à l’opposé de ce que font les jeunes générations d’acteurs : ils ne comprennent rien au corps tragique. Pour revenir à Alain Cuny, il fallait voir comment il envahissait tout l’espace, se traînait par terre ! Il scandalisait le public, certains sortaient ! Les explosions de désir sont intolérables à certains. L’avantage des chanteurs sur les acteurs, c’est qu’ils ont un corps chantant, vibrant, sur-sollicité – c’est-à-dire déjà tragique. Je sais qu’ils ont des choses très difficiles à faire, il ne faut pas déranger cela. Mais cette difficulté, justement, transcende leur corps. Il faut leur donner une direction et les laisser tranquilles, il faut leur épargner trop d’expérimentation, comme on peut en réclamer des comédiens. Mais à l’opéra, c’est plus facile, parce que la musique exprime directement l’inconscient des corps. Il n’y a plus aucune place pour l’anecdotique, le quotidien. Une manière de tendre la main, de se retourner, de s’asseoir, tout dans le corps des chanteurs est fascinant. Faire de soi-même une œuvre d’art : c’est ce à quoi sont parvenues Maria Callas à l’opéra, Sarah Bernard au théâtre, Ava Gardner au cinéma – des monstres de désir.
Propos recueillis par Dorian Astor
DU 23 AU 30 MAI 2023
Le Viol de Lucrèce
Benjamin Britten (1913-1976)
L’incorruptible patricienne Lucrèce peut-elle seulement survivre aux outrages de Tarquin, prince impulsif d’une Rome dépravée ? Après le succès de Peter Grimes, Britten choisit pour ce célèbre épisode de l’histoire romaine une forme inédite et bouleversante : un opéra de chambre, à la fois intimiste et d’une radicale violence.